Le faux prophète au service de la Bête (Ap 13,11-18)
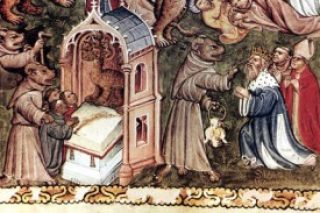
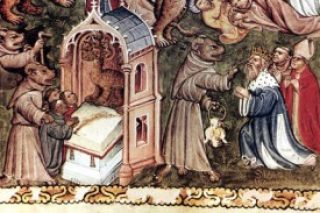

 Avoir gravé sur lui le nom de son Dieu, c’est participer à son Esprit, à sa Lumière, à son Amour… Tel est le fruit par excellence du baptême… Et le don de cet Esprit par lequel le Père a ressuscité son Fils d’entre les morts, nous donne à notre tour, de participer déjà, dans la foi, à la condition future des ressuscités (Ep 2,6 ; Col 2,12 ; Rm 8,11), au nom nouveau que Jésus porte… Enfin, cet Esprit reçu est celui qui habite en Plénitude le Père, le Fils et l’Esprit Saint, ces Trois Personnes divines qui vivent en communion dans « la Maison du Père » (Jn 14,1-4), le Royaume des Cieux (Rm 14,17 ; 2Co 13,13). C’est pour cela que ceux qui acceptent de recevoir ce Don de l’Esprit et qui essayent par la suite de lui demeurer fidèles par leur obéissance de cœur, reçoivent aussi « le nom de la Cité de mon Dieu » qui est en fait « communion »… Telle est la Jérusalem céleste (Ap 21,1-4) déjà offerte à notre foi par le Don de l’Esprit qui nous introduit dès maintenant, dans un mystère de communion, de cœur, avec Dieu… Alors, « heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru », car au milieu de toutes les épreuves de ce monde, ils vivent déjà, dans le secret de leur cœur, de la vie, de la paix et de la joie discrète mais souveraine du Royaume…
Avoir gravé sur lui le nom de son Dieu, c’est participer à son Esprit, à sa Lumière, à son Amour… Tel est le fruit par excellence du baptême… Et le don de cet Esprit par lequel le Père a ressuscité son Fils d’entre les morts, nous donne à notre tour, de participer déjà, dans la foi, à la condition future des ressuscités (Ep 2,6 ; Col 2,12 ; Rm 8,11), au nom nouveau que Jésus porte… Enfin, cet Esprit reçu est celui qui habite en Plénitude le Père, le Fils et l’Esprit Saint, ces Trois Personnes divines qui vivent en communion dans « la Maison du Père » (Jn 14,1-4), le Royaume des Cieux (Rm 14,17 ; 2Co 13,13). C’est pour cela que ceux qui acceptent de recevoir ce Don de l’Esprit et qui essayent par la suite de lui demeurer fidèles par leur obéissance de cœur, reçoivent aussi « le nom de la Cité de mon Dieu » qui est en fait « communion »… Telle est la Jérusalem céleste (Ap 21,1-4) déjà offerte à notre foi par le Don de l’Esprit qui nous introduit dès maintenant, dans un mystère de communion, de cœur, avec Dieu… Alors, « heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru », car au milieu de toutes les épreuves de ce monde, ils vivent déjà, dans le secret de leur cœur, de la vie, de la paix et de la joie discrète mais souveraine du Royaume…
 Et « c’est ici qu’il faut de la finesse ! Que l’homme doué d’esprit calcule le chiffre de la Bête, c’est un chiffre d’homme : son chiffre, c’est 666 » (Ap 13,18). C’est un chiffre d’homme : la clé est donc un nom d’homme… Ce chiffre ne renvoie donc pas à Satan, à l’Adversaire, mais à un homme qui fait son jeu en faisant le mal… Or tout le contexte pointe vers le nom d’un empereur romain… C’est donc dans cette direction que les recherches ont porté. St Irénée de Lyon (2°-3° s ap JC) proposait « lateinos » (latin) ou « teitan » (Titan)… Des copistes, sur certains manuscrits, ont aussi changé 666 en 616 pour arriver à l’empereur romain Caligula (surnommé Gaios Kaisar) ou pour désigner plus généralement tout empereur divinisé (Theos Kaisar)… Quoiqu’il en soit, « on retiendra que ce verset énigmatique ne prend tout son sens qu’à la lumière du contexte plus large des chapitres 13-18, où toutes les descriptions de la Bête et de ses activités convergent en direction de Rome et du pouvoir impérial » (Jean-Pierre Prévost).
Et « c’est ici qu’il faut de la finesse ! Que l’homme doué d’esprit calcule le chiffre de la Bête, c’est un chiffre d’homme : son chiffre, c’est 666 » (Ap 13,18). C’est un chiffre d’homme : la clé est donc un nom d’homme… Ce chiffre ne renvoie donc pas à Satan, à l’Adversaire, mais à un homme qui fait son jeu en faisant le mal… Or tout le contexte pointe vers le nom d’un empereur romain… C’est donc dans cette direction que les recherches ont porté. St Irénée de Lyon (2°-3° s ap JC) proposait « lateinos » (latin) ou « teitan » (Titan)… Des copistes, sur certains manuscrits, ont aussi changé 666 en 616 pour arriver à l’empereur romain Caligula (surnommé Gaios Kaisar) ou pour désigner plus généralement tout empereur divinisé (Theos Kaisar)… Quoiqu’il en soit, « on retiendra que ce verset énigmatique ne prend tout son sens qu’à la lumière du contexte plus large des chapitres 13-18, où toutes les descriptions de la Bête et de ses activités convergent en direction de Rome et du pouvoir impérial » (Jean-Pierre Prévost).