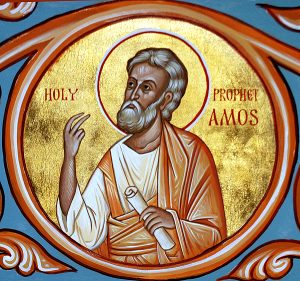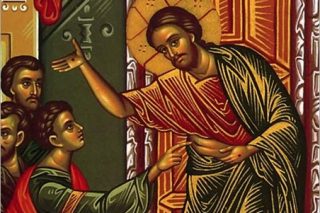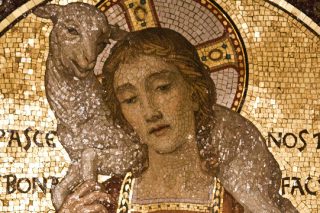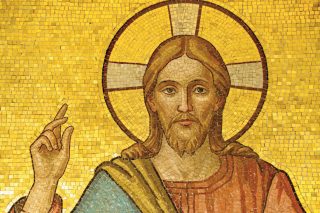Si nous participons régulièrement à la messe dominicale, nous sommes familiers de l’évangile de Luc, et nous savons que la parabole que nous venons d’entendre n’est pas le seul endroit de cet évangile où il est question du contraste entre la richesse et la pauvreté, et d’un renversement des destins. Dès le 1er chapitre de l’évangile de Luc, la Vierge Marie est la première à annoncer, dans son Magnificat, que le Seigneur « renverse les puissants de leurs trônes, élève les humbles, comble de biens les affamés, et renvoie les riches les mains vides » (cf. Lc 1, 52-53).
Nous pouvons aussi penser au discours inaugural de Jésus qui se trouve au ch. 6. Jésus déclare « Heureux » les pauvres, et ceux qui ont faim parce que le royaume de Dieu est à eux et qu’ils seront rassasiés. Au contraire, Jésus qualifie les riches et les repus de « malheureux », parce qu’ils ont leur consolation, et qu’à l’avenir, ils auront faim ». (cf. Lc 6, 20-21 ;24-25).
Dans la parabole que nous venons d’entendre, Jésus dit au sujet de l’homme riche qu’il est « vêtu de pourpre et de lin fin, et qu’il faisait chaque jour des festins somptueux » (Lc 16, 19). Le texte grec nous dit littéralement que chaque jour, cet homme « menait une vie joyeuse [εὐφραίνω] et somptueuse ». Saint Luc l’évangéliste ne nous rapporte-t-il pas une autre parabole de Jésus dans laquelle il est aussi question d’un personnage riche qui veut profiter de la vie ? Il s’agit évidemment de l’histoire d’un propriétaire de domaine qui décide d’agrandir ses greniers, et qui, oubliant la précarité de la vie, se dit en lui-même : « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence [εὐφραίνω].” (cf. Lc 12, 16-21).
Dans cette parabole que nous venons de nous remettre en mémoire, l’erreur dans le raisonnement de ce riche propriétaire, sa « folie » pourrait-on dire, est sans doute de n’avoir pensé ni à Dieu, ni à son prochain dans sa réflexion. Dans la Bible, la « propriété égoïste » a souvent une issue fatale. Et cette issue fatale de la propriété égoïste est justement ce qu’annonce le prophète Amos dans la première lecture.
Le prophète Amos a exercé son ministère prophétique en Samarie au 8ème siècle avant J.C, pendant une période où les échanges commerciaux avec l’étranger avaient amené une certaine prospérité dans le pays. Cette période aurait pu être un temps béni s’il avait conduit à un élan de solidarité entre les membres du peuple de Dieu. Malheureusement, cette période de prospérité n’a fait qu’accentuer les déséquilibres sociaux entre les riches et les pauvres, et les puissants n’hésitaient pas à exploiter les indigents.
Le prophète Amos dénonce le comportement de ces riches qui vivent dans le luxe, et qui pensent que leur argent et leurs biens les protègeront au jour de l’épreuve, sans se rendre compte que par leur attitude mauvaise, ils accélèrent la venue du jugement :
« Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau (…) ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! (…) C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés…» (Am 6, 4-7)
Amos est un prophète, et de ce fait, il observe et il médite sur les évènements qui marquent la vie de son pays et ceux des pays voisins. Observant l’expansion de l’Empire Assyrien, le prophète Amos pressent la façon dont le jugement de Dieu va se manifester contre les notables de Samarie, à savoir, la prise de leur pays par l’armée assyrienne, et la déportation d’une grande partie de sa population. Cette prophétie d’Amos finira par se réaliser en 722 (avant J.C.).
Venons-en au texte d’évangile.
 Il s’agit d’une parabole que Jésus adresse aux Pharisiens. Jésus commence par présenter les deux personnages, un homme riche anonyme qui profite des plaisirs de la vie que son argent peut lui obtenir, et un pauvre nommé Lazare, qui est couvert d’ulcères, et qui git au portail du riche. Dans le texte grec, Jésus dit littéralement que ce pauvre Lazare « avait été jeté » devant le portail du riche. Jésus emploie le verbe « jeter » [βάλλω] à la voie passive, comme s’il voulait signifier que Lazare n’a pas été maître de sa destinée. Nous y reviendrons.
Il s’agit d’une parabole que Jésus adresse aux Pharisiens. Jésus commence par présenter les deux personnages, un homme riche anonyme qui profite des plaisirs de la vie que son argent peut lui obtenir, et un pauvre nommé Lazare, qui est couvert d’ulcères, et qui git au portail du riche. Dans le texte grec, Jésus dit littéralement que ce pauvre Lazare « avait été jeté » devant le portail du riche. Jésus emploie le verbe « jeter » [βάλλω] à la voie passive, comme s’il voulait signifier que Lazare n’a pas été maître de sa destinée. Nous y reviendrons.
Lorsque ces deux hommes meurent, Lazare est emporté par les anges auprès d’Abraham, c’est-à-dire dans un espace agréable réservé aux justes. Quant au riche, après avoir été enterré, il se retrouve dans une position inconfortable, en proie à la torture.
Toutefois, de là où il se trouve, le riche a la possibilité de voir Lazare qu’il n’avait pas su regarder pendant sa vie. La vision du bonheur de Lazare aux côtés d’Abraham semble éveiller sa culpabilité.
Peut-être à cause de la honte qu’il ressent, le riche n’ose pas s’adresser directement à Lazare, et choisit de s’adresser à Abraham. Il l’appelle « Père » ; « Père Abraham ». Cet indice nous permet de deviner que ce riche de la parabole est israélite. Il fait partie du Peuple de Dieu. De ce fait, il connait la Loi, et il sait que la Loi commande de venir en aide à son frère israélite. « Tu n’endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux » lisons-nous dans le Livre du Deutéronome (Dt 15, 7). Ayant conscience de n’avoir pas marché selon la Loi du Seigneur durant sa vie, le riche doit penser qu’il mérite son châtiment. C’est sans doute la raison pour laquelle il ne demande pas au patriarche d’être libéré du lieu où il se trouve, et qu’il se contente de lui demander un petit soulagement, « que Lazare trempe le bout de son doigt dans l’eau, et qu’il vienne lui rafraîchir la langue » (cf. Lc 16, 24). Abraham refuse une première fois :
« Mon enfant, souviens-toi (…)Tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation » (16, 25)
Pour Abraham, il n’est pas question d’empêcher Lazare de profiter d’un bonheur enfin acquis après une vie de malheur en lui demandant de se rendre dans un « lieu de torture ». Abraham ajoute une autre raison à son refus : un grand abîme empêche la communication dans un sens comme dans l’autre.
Le riche ne se décourage pas, et adresse à Abraham une autre demande un peu moins égoïste : envoyer Lazare dans la maison de son père pour témoigner auprès de ses frères, afin que ces derniers ne subissent pas le même sort que lui. Abraham refuse encore une fois. Il n’est pas question d’empêcher Lazare de profiter du repos après une vie de souffrance en l’envoyant en mission dans la maison du riche. Mais surtout, comme tout juif, les frères de cet homme riche sont censés écouter Moïse et les prophètes. En fait, Abraham suggère au riche que s’il avait eu une écoute obéissante de la Loi et des prophètes pendant sa vie, il aurait pu se convertir, éviter son sort néfaste, et goûter lui aussi au bonheur dans l’au-delà.
« Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! » (Lc 16, 29)
Par ailleurs, nous savons que dans l’évangile de Luc, Jésus se présente indirectement comme un prophète. Par exemple, au début de son ministère, dans la synagogue de Nazareth, il déclare « qu’un prophète n’est pas reçu dans sa patrie » (4, 24ss.). Ou encore, pendant sa montée vers Jérusalem, il déclare « qu’il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem » (13, 33). Nous pourrions ajouter qu’à plusieurs endroits de l’évangile, Jésus parle du sort des prophètes qui ont été persécutés et tués (11, 47-48 ; 11, 50-51 ; 13, 33-34).
Cela nous permet de comprendre, que lorsque dans sa parabole, Jésus met dans la bouche d’Abraham une exhortation à écouter Moïse et les prophètes, c’est aussi une exhortation à l’écouter sa Parole, et notamment la parabole qu’il est en train de prononcer.
Alors que pouvons-nous retenir de cette parabole du pauvre Lazare et du riche ? Tout d’abord, nous avons vu que Lazare « avait été jeté » devant le portail du riche, et que le verbe « jeter » à la voie passive suggérait que sa situation misérable était quelque chose sur laquelle il n’avait pas eu de contrôle. Il m’arrive parfois d’entendre des gens dire au sujet de sans-abris qu’ils croisent dans la rue que « s’ils sont dans cette situation de misère, c’est parce qu’ils l’ont choisi ». Avec l’exemple de Lazare, Jésus nous rappelle que pour la plupart d’entre eux, la situation dans laquelle ils se trouvent n’est pas un choix. Ils subissent leur misère.
Ensuite, Jésus veut nous inciter à faire le choix du partage et de l’équité MAINTENANT, pendant que nous pouvons encore agir, avant qu’il ne soit trop tard. Jésus veut éviter que ses auditeurs plus aisés ne subissent un sort semblable à celui du riche au séjour des morts. Mais il veut aussi éviter à ses auditeurs plus pauvres, une vie comme celle de Lazare ici-bas. Alors, lorsque cela nous est possible, « sans nous mettre dans la gêne, essayons de soulager » (cf. 2 Co 9, 13) la misère de nos frères et sœurs les plus pauvres.
Je terminerai par un petit mot sur le passage de la Première Lettre à Timothée que nous avons entendu en seconde lecture. Il s’agit d’une série de consignes données à Timothée pour qu’il soit un homme de Dieu. Dans la mesure où nous voulons tous être des hommes et des femmes de Dieu, ces consignes nous concernent. Nous lisons ceci :
« Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur ». (1 Tm 6, 11)
Tout d’abord, nous devons rechercher la justice. Nous savons que la justice est un attribut divin, et que la justice de Dieu est liée la miséricorde et le salut. Par exemple, dans le Livre d’Isaïe, le Seigneur dit :
« Ma justice, je l’ai fait approcher : elle n’est pas loin, et mon salut ne tardera pas » (Is 43, 13)
ou encore :
« Je rendrai proche ma justice, mon salut va paraître » (53, 5).
Bref, comprenons que « rechercher la justice » ne signifie pas que nous avons le droit de juger et condamner les autres, mais que nous devons au contraire, être bienveillants, et miséricordieux avec eux, et désirer leur salut.
 Ensuite nous devons rechercher la piété. Faisons attention. La piété dont nous parle Paul n’est pas la multiplication des dévotions… Quelques versets avant notre passage, l’Apôtre met en garde Timothée contre ceux qui n’enseignent pas les paroles solides de Jésus, et au sujet des « paroles de Jésus, Paul parle « d’enseignement en accord avec la piété » (cf. 1 Tm 6, 3). Donc, nous comprenons que la piété à laquelle nous sommes appelée, est liée aux Paroles de Jésus. On pourrait dire qu’il s’agit tout simplement que la piété c’est être enracinés dans les enseignements de N.S Jésus Christ.
Ensuite nous devons rechercher la piété. Faisons attention. La piété dont nous parle Paul n’est pas la multiplication des dévotions… Quelques versets avant notre passage, l’Apôtre met en garde Timothée contre ceux qui n’enseignent pas les paroles solides de Jésus, et au sujet des « paroles de Jésus, Paul parle « d’enseignement en accord avec la piété » (cf. 1 Tm 6, 3). Donc, nous comprenons que la piété à laquelle nous sommes appelée, est liée aux Paroles de Jésus. On pourrait dire qu’il s’agit tout simplement que la piété c’est être enracinés dans les enseignements de N.S Jésus Christ.
« … Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur ». (1 Tm 6, 11)
Après la piété, après l’écoute des Paroles de Jésus, vient la foi. La foi est la seule chose requise pour être sauvé. Il s’agit tout simplement de faire confiance aux croyants qui nous ont précédés, et de croire à la bonne nouvelle qu’ils nous ont transmise, à savoir que Dieu nous aime de manière inconditionnelle, et que dans la personne du Christ, Dieu a réconcilié définitivement l’humanité avec lui, et que de ce fait, nous sommes appelés à la Vie.
Maintenant, si nous sommes aimés par Dieu ; si nous sommes sauvés par Lui sans aucune condition, nous devons avoir un comportement qui soit cohérent avec notre foi. Nous devons nous efforcer à aimer nos frères et sœurs sans condition, comme Dieu les aime. D’où la mention de la charité juste après celle de la foi.
Enfin, nous devons exercer cette charité persévérante dans la douceur.
Alors frères et sœurs, comme nous exhorte saint Paul, « Menons le bon combat, celui de la foi, emparons-nous de la vie éternelle ! Car c’est à elle que nous avons été appelée » (1 Tm 6, 12).
P. Alexandre ROGALA (MEP).