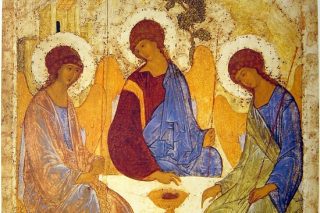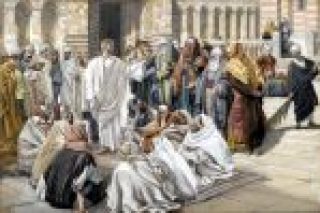Il n’y a pas de politique chrétienne, cependant il existe une manière chrétienne de faire de la politique. À la lumière de la doctrine sociale de l’Église, je voudrais partager ici l’enseignement de quelques principes fondamentaux.
La foi catholique a joué un rôle majeur dans cette naissance de l’Union européenne comme le montre la figure de Robert Schuman (+1963), l’un des pères fondateurs de l’Europe, dont le procès de béatification est en cours.
Un arbre peut nous empêcher de voir la forêt. Les difficultés du quotidien risquent de nous faire oublier la grandeur de l’existence.
-
L’Union européenne, source de paix
Pour la première fois dans l’histoire du monde, les pays européens bénéficient d’une longue période de paix sur leurs terres et cela grâce en grande partie à l’Union européenne. Les monuments aux morts de nos places, les carrefours des rues et les fêtes du calendrier nous rappellent les dernières guerres mondiales qui ne sont pas si loin. On ne gagne pas la guerre, on gagne la paix.
Le spectacle de blessés et de morts aux cours des guerres nous fait penser à la passion de domination des hommes, le tragique infantilisme de vouloir être le plus fort, le plus viril, et aux forces du mal et du malin[2].
 Le saint pape Jean-Paul II (+2005), polonais, redoutait l’Union soviétique qui avait imposé une véritable dictature. Le père Pedro Arrupe S.J. (Bilbao 1907-Rome 1991), ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, redoutait les États-Unis qui avaient jeté la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Médecin, missionnaire au Japon, le père jésuite Pedro Arrupe avait soigné les malades à Hiroshima. Jean-Paul II connaissait peu l’Amérique latine avec les dégâts du capitalisme et du libéralisme sur ce continent, tandis que le père Arrupe avait éprouvé en sa chair la violence de la bombe atomique d’Hiroshima, lâché par les États-Unis, pays libéral et apôtre du capitalisme[3].
Le saint pape Jean-Paul II (+2005), polonais, redoutait l’Union soviétique qui avait imposé une véritable dictature. Le père Pedro Arrupe S.J. (Bilbao 1907-Rome 1991), ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, redoutait les États-Unis qui avaient jeté la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Médecin, missionnaire au Japon, le père jésuite Pedro Arrupe avait soigné les malades à Hiroshima. Jean-Paul II connaissait peu l’Amérique latine avec les dégâts du capitalisme et du libéralisme sur ce continent, tandis que le père Arrupe avait éprouvé en sa chair la violence de la bombe atomique d’Hiroshima, lâché par les États-Unis, pays libéral et apôtre du capitalisme[3].
Aujourd’hui, la Russie et les États-Unis représentent des dangers considérables et différents. La puissance de la Chine avec son capitalisme d’État est à intégrer dans l’échiquier mondial. Il s’avère nécessaire d’affermir la civilisation européenne. L’Union européenne avec ses 27 pays membres peut représenter une force respectable ; ce qui est impossible à un seul pays devient possible ensemble, dans l’UE.
-
Arme nucléaire, arme économique, arme diplomatique
Au début de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, il était question de parvenir assez rapidement à une victoire en utilisant « l’arme économique » : blocage des avoirs russes, arrêt des importations … Les produits importés de la Russie comme le gaz demeurent une source de richesse pour la Russie.
Aujourd’hui il est plutôt question de multiplier l’engagement militaire. Pourquoi ne pas développer « l’arme économique » qui demande évidemment des renoncements dans le niveau de vie européen ?
Il reste aussi l’arme diplomatique au service de la paix et de la justice.
Le Saint-Siège fait appel aux solutions diplomatiques à travers le dialogue. Il propose aussi le principe de réciprocité qui n’est pas le banal « donnant-donnant », mais la perfection dans l’échange. Aristote et saint Thomas d’Aquin mettaient déjà en valeur l’idéal de la réciprocité au-dessus de la bienveillance et plénitude dans les relations où chaque membre agit dans l’égale dignité. L’Union européenne avec son patrimoine culturel et spirituel peut apporter une diplomatie propre de manière à proposer non une simple diplomatie des affaires mais une diplomatie de la reconnaissance des droits humains notamment en politique et en matière de liberté religieuse. La France et l’Europe accordent les mêmes droits à ses citoyens ; il n’en va pas de même pour certains pays qui envoient leurs compatriotes en Europe et qui exigent l’égalité des droits et de liberté religieuse en Europe mais sans réciprocité.
L’Évangile de Jésus le Christ enseigne la Règle d’or : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes » (Mt 7,12).
-
La prière
« Nos idées changent quand on les prie », aimait à dire Georges Bernanos (+1948), l’écrivain catholique. Le but de la prière étant le don de l’Esprit Saint, il convient de l’invoquer pour discerner au moment du vote.
-
Voter : un droit et un devoir
Nombreux sont ceux qui se désintéressent de la politique en invoquant leur déception. Mais s’ils ne s’intéressent pas à la politique, la politique s’intéresse à eux avec des conséquences à regretter. Le principe de la participation à la vie sociale fait partie des éléments fondamentaux de la doctrine sociale de l’Église. Chacun reste responsable de la marche de la politique et de l’économie. Ne pas y participer peut représenter une faute voire un péché d’omission pour les croyants chrétiens. Certains pays comme la Belgique prévoient des sanctions pour les citoyens qui ne se rendent pas aux urnes, dans le souci d’empêcher l’auto-exclusion du processus démocratique.
-
Partir des pauvres
Le pape François exhorte à regarder le monde à partir des pauvres, avec leurs yeux et leur cœur. « D’où parles-tu ? », question classique renvoie aux conditionnements des pensées selon le contexte social. Les avis changent selon que nous partons de la finance ou du milieu de vie des personnes vulnérables. Les jeunes chômeurs, les malades ou les personnes âgées ne sont pas à considérer comme des boulets qui empêchent le développement mais comme le capital humain dont la dignité demeure intérieure, inaliénable, universelle et sacrée.
À ce propos, il est bon de citer le préambule de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 : « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres[4] ». La Suisse, façonnée par les Églises catholique et protestante, fait apparaître dans son droit constitutionnel la manière évangélique de faire de la politique qui consiste à partir du plus vulnérable des citoyens et non des projets idéologiques ou des multinationales.
Les personnes vulnérables apportent souvent le regard juste et opportun bien nécessaire aux politiques menacés par devenir « hors sol » et aux technocrates privilégiés qui vivent entre eux. Il me vient à la mémoire, la démarche que la reine d’Espagne, Sophie de Grèce, qui tenait à faire le tour du monde jusqu’en 2014 au nom de la politique internationale de l’Espagne. Quand elle se rendait dans des pays pauvres comme Haïti pour promouvoir des projets de développement choisissait des milieux pauvres, inconnus parfois des politiques, qui en avaient honte. Une reine étrangère leur faisait découvrir des situations douloureuses de leur propre pays !
-
Bien commun plutôt qu’intérêt général
Il est rare que les politiques utilisent le concept de bien commun ; ils préfèrent parler d’« intérêt général ». Pourtant, le contenu et l’esprit diffèrent considérablement. « Intérêt » évoque souvent des intérêts matériels personnels ou de groupes de pression, loin des idéaux humains altruistes. « Général » reste un terme vague qui se prête aux manipulations des « lobby » ou à des décisions qui sacrifient la dignité de certaines personnes ou populations: « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ».
Le Concile Vatican II a donné une définition qui mérite l’effort de son analyse car elle apporte le respect des personnes et des groupes dans une vision d’humanisme intégral et communautaire : « L’ensemble de conditions sociale qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée » (Gaudium et spes, n°26). Il ne s’agit pas uniquement de posséder davantage mais de parvenir à la perfection de « tout l’homme et de tous les hommes » selon l’heureuse formule du pape saint Paul VI. Pour le bien commun, la personne n’est jamais réduite à un moyen ; aucun groupe minoritaire n’est sacrifié dans ses droits et dans sa culture au nom de « l’intérêt général » comme l’acquisition de devises ou des résultats économiques.
-
Droit à la vie et non droit à donner la mort
Quand on étudie toutes les déclarations des droits humains qui jalonnent l’histoire de l’humanité pour parvenir à la liberté et à la dignité, il est toujours question de droit à la vie et nulle part de droit à donner la mort.
En ce sens, le pape François trouve insensée la démarche d’inscrire le droit à l’IVG dans une Constitution. L’Église est Mère ; comme toutes les mères elle veille sur la vie des enfants qu’elle protège et soutient. Au premier siècle, dans l’Empire romain, le père de famille avait droit de vie et de mort sur son enfant qu’il pouvait aussi vendre comme esclave. Le christianisme a mis en valeur la dignité de l’enfant. Il ne faudrait pas revenir en arrière. Les hommes ne sont pas les propriétaires de la vie qu’ils ont reçu comme un don mais ses gestionnaires.
Comment se fait-il que dans notre île où la majorité de ses habitants sont religieux dont les religions plaident pour la vie des enfants, ses députés puissent se réjouir en grand nombre de l’inscription de l’IVG dans la Constitution ? Était-ce un vrai besoin urgent ? Représentent-ils les Réunionnais chrétiens, musulmans et d’autres religions ou d’autres pensées qui n’approuvent pas de manière majoritaire l’interruption de la vie ? Pourquoi les Réunionnais des différentes religions n’ont-ils pas exprimé davantage leur avis à la lumière de la science et de leur foi ?
En ce qui concerne l’euthanasie, certains gouvernements comme celui du Canada n’ont pas caché l’enjeu économique et la réduction de dépenses que cela peut comporter. Mais la vie humaine ne se réduit pas à l’argent.
-
« Zoreil dehors » et le programme Erasmus
Il y a un peu plus de trente ans, quand je suis arrivé à La Réunion, je voyais de temps en temps écrire sur des murs « zoreil dehors ». Parfois des blancs créoles parlant créole subissaient dans la rue le dard « zoreil dehors ». À présent, je ne le vois plus. Les mentalités ont évolué : Internet, les voyages avec la continuité territoriale, le programme Erasmus qui permet aux étudiants réunionnais d’étudier dans d’autres pays de l’UE … Nouvelle et heureuse mobilité.
L’esprit des Réunionnais s’est de plus en plus ouvert aux relations internationales. La langue anglaise occupe une place de choix non seulement dans les études mais aussi dans de nombreuses célébrations de mariages …
Nous avons à distinguer « autonomie » et « indépendance ». Comme son étymologie l’explique, « auto-nomie » se mouvoir (auto=soi-même) par sa propre loi (nomos) ne s’oppose pas à indépendance. Nous sommes dépendants les uns des autres.
Grandir dans l’UE peut très bien s’harmoniser avec le développement de la culture créole ; comme le dit le poète andalou Juan Ramón Jíménez, prix Nobel de littérature : « Des racines et des ailes, mais des racines pour s’envoler et des ailes pour s’enraciner ». Devenir de plus en plus créole pour devenir de plus en plus européen et réciproquement.
-
Lois européennes et exceptions régionales : déchets alimentaires
La doctrine sociale de l’Église prône le principe de subsidiarité qui représente un droit et un soutien comme son étymologie le manifeste : subsidiarité vient de latin subsidium qui veut dire « aide, soutien ». Le principe de subsidiarité peut être défini comme ceci : « Donner la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d’autorité compétent pour résoudre le problème ».
Il importe de bien choisir les députés européens qui vont défendre ce principe de subsidiarité de manière à ce qu’à la base des Réunionnais puissent exercer leurs compétences dans le contexte de leur culture et de leur économie, en faisant appel au principe de l’exception régionale si nécessaire.
Par exemple, chaque jour, dans les cantines scolaires, publiques ou privées, autour de 30% de la nourriture part à la poubelle de manière obligatoire et cela semble-t-il en raison des lois européennes. Véritable gaspillage dans un monde où tant de personnes souffrent de la faim ! Il doit y avoir moyen de récupérer de manière raisonnable cette nourriture pour la transformer en engrais ou en nourriture pour l’élevage des porcs, ce qui devrait créer des emplois et favoriser l’autonomie alimentaire dont le besoin s’est bien fait sentir au cours des gilets jaunes et de la pandémie.
-
Rencontrer les députés européens
De nombreuses études sociologiques relèvent la croissante distance entre les députés et la population qui reconnaît très souvent ne pas connaître les élus politiques. L’inverse pourrait être vrai aussi : des politiques qui méconnaissent les besoins et les demandes de la population.
Les corps intermédiaires de la société civile gagneront à se rapprocher des candidats et des élus et à les interpeller sur leurs programmes tout en leur faisant des propositions.
 La Réunion demeure une île mariale. Le drapeau européen avec ses douze étoiles sur un fond bleu ciel rappelle la femme de l’Apocalypse « couronnée de douze étoiles, elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail d’enfantement » (Ap 12, 1-2). Des théologiens ont vu en cette femme couronnée d’étoiles une figure de l’Église et de la Vierge Marie. Puisse Notre-Dame intercéder pour l’Europe dans les douleurs et le travail d’enfantement de la justice et de la paix.
La Réunion demeure une île mariale. Le drapeau européen avec ses douze étoiles sur un fond bleu ciel rappelle la femme de l’Apocalypse « couronnée de douze étoiles, elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail d’enfantement » (Ap 12, 1-2). Des théologiens ont vu en cette femme couronnée d’étoiles une figure de l’Église et de la Vierge Marie. Puisse Notre-Dame intercéder pour l’Europe dans les douleurs et le travail d’enfantement de la justice et de la paix.
Saint-Denis/ la Réunion, le 1er juin 2024.
[1] Dominicains. Cathédrale de Saint-Denis. Aumônier catholique de la prison de Domenjod (La Réunion). Doyen de la faculté des sciences sociales de DOMUNI-universitas https://www.domuni.eu/fr/
[2] Le pape François a cité la réflexion de sagesse de La Pira (1904-1977), ancien maire de Florence (Italie), laïc dominicain, dans le contexte de la guerre actuelle : « La situation historique que nous vivons, le choc des intérêts et des idéologies qui secouent l’humanité en proie à un incroyable infantilisme, redonnent à la Méditerranée une responsabilité capitale : redéfinir les règles d’une Mesure où l’homme livré au délire et à l’excès peut se reconnaître » (Discours au Congrès méditerranéen de la culture, 19 février 1960)[2]. »
[3] Certaines photos montrent le pape Jean-Paul II et le père Arrupe regardant en direction opposée ; d’où la légende explicative de la photo : « Deux regards divergents ». En réalité, le pape Jean-Paul II et le père Arrupe regardaient dans la même direction : le Christ Jésus et la justice sociale. Mais ils le faisaient à partir d’expériences différentes, de pays différents avec des points de vue divers, sans opposition sur le fond. Saint Thomas d’Aquin enseignait : « Dans les choses qui ne sont pas de la nécessité de la foi, il a été permis aux saints, il nous est permis à nous d’opiner de diverses manières[3]. »
[4] Cf. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html